Qu'est-ce que la période suspecte dans une procédure collective ?
Roxane Hidoux - Juriste en droit des entreprises |
|
La période suspecte est la période se situant entre la date cessation des paiements fixée par le Tribunal et l'ouverture d'une procédure collective.
Le Tribunal de commerce se réserve la possibilité d'examiner la période suspecte afin de remettre en cause certains actes commis par le dirigeant de l'entreprise.
 |
Recouvrer une facture impayée |
Télécharger le guide → |
Sommaire
Combien de temps dure la période suspecte ?
La période suspecte a pour point de départ la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements.
En général, le Tribunal de commerce fixe la date de cessation des paiements au jour de la déclaration de cession des paiements (ou dépôt de bilan). Le Tribunal a par la suite la possibilité de repousser cette date, si certains faits le conduisent à penser que les conditions d'une cessation des paiements étaient réunies plus tôt.
En pratique, la date de la cessation des paiements peut être compliquée à déterminer, notamment lorsque l'entreprise en difficulté est parvenue à obtenir des délais de paiement ou des remises de dettes.
Les tribunaux se basent sur différentes indices pour déterminer la date de cessation des paiements :
- l’inscription d’un privilège sur "l’état des inscriptions et privilèges", le plus souvent par un organisme social tel que l'URSSAF (au titre d’une ou plusieurs échéances de charges sociales impayées),
- le déclenchement d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur,
- l'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer par un fournisseur non payé,
- toute condamnation judiciaire à payer une créance (dommages et intérêts, forte amende...),
- le rejet d'un chèque ou d'une traite.
La période suspecte se termine le jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle peut couvrir une période de 18 mois.
Il n’existe pas de période suspecte dans la procédure de sauvegarde, car son recours ne suppose pas d’état cessation des paiements.
Compte courant d'associé - cadre et conventions
Pour encadrer cette relation financière, le guide "Ouvrir et gérer un compte courant d'associé" détaille le cadre juridique et fournit les conventions types pour :

- Respecter les conditions légales d'ouverture et de fonctionnement
- Rédiger la convention de compte courant d'associé
- Déterminer et comptabiliser la déduction des intérêts
- Gérer les situations de blocage et les modalités de remboursement
- Conditions d'ouverture
- Convention de compte courant
- Déduction des intérêts
- Blocage et remboursement du compte courant
Que deviennent les actes réalisés pendant la période suspecte ?
La détermination de la période suspecte permet d'identifier d’éventuels actes présumés frauduleux du fait soit du dirigeant de l'entreprise en difficulté soit même d’un tiers.
Le but est de sanctionner les actes ayant pour objet ou pour effet de disperser l’actif de l'entreprise ou d’avantager indûment certains créanciers par rapport à d’autres. Ces actes pourront être annulés.
En effet, l'entreprise en difficulté ne doit pas avoir favorisé un partenaire au détriment de ses créanciers, notamment :
- en favorisant un créancier,
- en vendant des actifs à un prix anormalement bas,
- en donnant des actifs,
- en payant selon un mode anormal (par exemple avec du matériel),
- en donnant des garanties pour une dette antérieure,
- en consentant un contrat de travail avec des conditions particulièrement anormales...
Établir une facture conforme
Pour facturer en toute sécurité juridique, le guide "Rédiger et gérer ses factures" détaille les mentions légales impératives et fournit des modèles adaptés pour :

- Intégrer toutes les mentions obligatoires
- Appliquer correctement les règles de TVA et les exonérations
- Respecter les délais de paiement légaux et les pénalités de retard
- Engager les recours en cas d'impayé (relance, injonction de payer)
- Mentions obligatoires
- Gestion de la TVA
- Délais de paiement
- Recours en cas d'impayé
Quels sont les actes qui encourent la nullité ?
Les actes automatiquement annulés
Les actes énumérés à l'article L 632-1, I du Code de commerce sont automatiquement annulés :
- les donations réalisées au cours de la période suspecte, en raison de la situation de fragilité dans laquelle l'entreprise se trouvait au moment où ils sont été accomplis,
- les contrats dans lesquels les obligations de l'entreprise excèdent notablement celles de l’autre partie, soit parce qu'ils ont été conclus sans contrepartie pour l'entreprise ou pour une contrepartie dérisoire,
- le paiement de factures que l'entreprise n’était pas tenue de payer car non encore arrivées à échéance, permettant ainsi au créancier d'échapper à la procédure de répartition,
- le paiement de factures arrivées à échéance réalisées autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires : remise partielle de stocks, restitution de marchandises, cession de créances, compensation ...,
- toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits de l'entreprise en difficulté pour des dettes contractées avant la période suspecte,
- toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée constitués sur les biens de l'entreprise pour des dettes contractées avant la période suspecte (ce qui exclut une cession de créances à titre de garantie par voie de bordereau Dailly),
- les mesures conservatoires, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements,
- toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, pour les EIRL,
- la déclaration d'insaisissabilité réalisée pendant la période suspecte,
- la levée d’option, destinée à acquérir de manière préférentielle des actions (les stock-options).
L'entreprise qui aura ainsi effectué ces actes pendant la période suspecte les verra automatiquement annulés par le juge sans appréciation de leur bien fondé.
Conclusion d'un contrat de travail pendant la période suspecte
Le contrat de travail n'échappe pas par principe au risque de nullité de la période suspecte.
Le contrat de travail sera ainsi considéré comme étant un contrat déséquilibré lorsqu'il prévoit une rémunération à un niveau très supérieur aux minima applicables à la catégorie d’emploi du salarié et ce, en dépit des difficultés majeures que l'entreprise connaissait alors (Cass soc 16 juin 2004 n°02-41623).
De même, un contrat de travail qui a pour unique objet de faire bénéficier le dirigeant de droits sociaux auxquels il ne pouvait prétendre est considéré comme étant fictif (Cass soc 19 juin 2001 n°99-42738).
Dans ces 2 cas, les conséquences sont identiques : la nullité rétroactive du contrat de travail, avec pour conséquence la restitution par le salarié des salaires perçus.
Le pseudo salarié a cependant la faculté de demander l'indemnisation de ses prestations, indemnisation qui ne correspondra pas nécessairement au montant des salaires versés. Mais encore faut-il que le salarié sollicite cette indemnisation et ne se limite pas à demander au Tribunal la fixation de sa créance salariale (Cass com 20 mars 2019 n°18-12582).
Location-gérance de fonds de commerce
Le guide "Mettre en place une location-gérance" détaille le régime juridique applicable et fournit le modèle de contrat type pour :
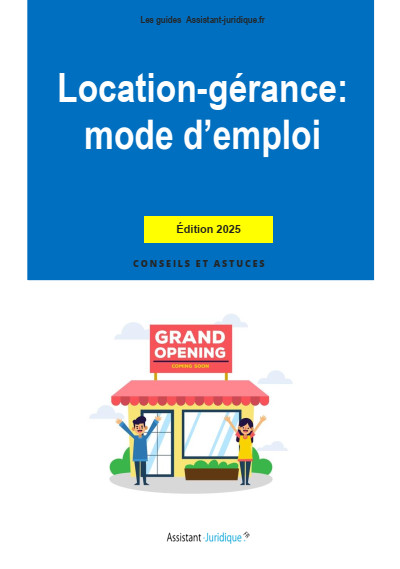
- Respecter les conditions légales et les interdictions
- Rédiger les clauses essentielles du contrat (objet, durée, redevance)
- Calculer et déclarer le paiement de la redevance de location-gérance
- Anticiper et gérer les causes et conséquences de la rupture du contrat
- Conditions à respecter
- Clauses du contrat
- Calcul et paiement de la redevance
- Rupture du contrat
Les actes soumis à l'appréciation du Tribunal
Le Tribunal a la possibilité, mais pas l'obligation d'annuler certains actes, lorsqu'ils ont été réalisés pendant la période suspecte avec un créancier qui avait connaissance de la cessation de paiement.
Sont visés les actes suivants :
- le paiement de certaines dettes, qui auraient été payées de façon anormale, ou au détriment d'autres créanciers (l'entreprise doit respecter le principe d'égalité des créanciers),
- tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci,
- la déclaration d'insaisissabilité réalisée dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements,
- la vente d'un actif réalisé au profit d'une personne connaissant la situation de cessation des paiements de l'entreprise et à un prix anormalement bas.
La difficulté sera alors d'établir que le créancier avait connaissance, au moment de la conclusion de l'acte litigieux, de l'état de cessation des paiements de l'entreprise en difficulté.
Le Tribunal doit établir concrètement et précisément en quoi le bénéficiaire de l'acte avait connaissance, au moment de l'acte litigieux, de l'état de cessation des paiements de l'entreprise en difficulté.
Dans le cas d'une vente, le Tribunal examinera ainsi si le bien a été vendu pour soustraire une partie des actifs aux créanciers.
Il pourra annuler la vente, avec pour conséquences :
- de faire revenir l'actif dans le patrimoine de l'entreprise ;
- et de condamner l'acheteur à déclarer une créance égale au prix qu'il aurait dû payer et pour laquelle il ne sera pas le plus souvent remboursé.
Ainsi, toute vente d'actif doit être scrupuleusement motivée, et justifiée en prix par une expertise indépendante, et ce pour limiter le risque qu'un créancier ne traîne devant un tribunal le dirigeant de l'entreprise en difficulté.
Recouvrer une facture impayée efficacement
Pour recouvrer vos créances efficacement, le guide "Recouvrer un impayé" détaille les voies de recours et fournit les modèles de courriers pour :

- Respecter les délais de prescription et agir dans les temps
- Rédiger et envoyer des relances et mises en demeure efficaces
- Engager une procédure d'injonction de payer ou une assignation en justice
- Calculer et réclamer les pénalités de retard et les frais de recouvrement
- Délais de prescription
- Relances et mises en demeure
- Injonction de payer et assignation en paiement
- Pénalités de retard et frais de recouvrement
🚀 Passez à l'action avec nos guides pratiques
🎯 Pour approfondir ce thème



Pack Juridique Dirigeant d'Entreprise
9 guides à jour :
✅ Dividendes et compte courant d'associé
✅ Remboursement de frais
✅ Devis, factures et impayés


