Licenciement pour inaptitude : procédure à suivre
Roxane Hidoux - Juriste en droit des entreprises |
|
Un salarié peut être licencié pour inaptitude suite à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou toute autre problème de santé.
 |
Saisir le Conseil de Prud'hommes |
Télécharger le guide → |
Sommaire
Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude est un mode spécial de licenciement qui permet de rompre le contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail et dont le reclassement est impossible.
L'inaptitude en tant que telle peut en effet constituer une cause de licenciement dans la mesure où le salarié déclaré inapte ne peut plus exercer les tâches pour lesquelles il a été embauché, sans que soit portée une atteinte à son intégrité physique ou à sa santé.
L'inaptitude peut être physique ou mentale, d'origine professionnelle (causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle) ou non professionnelle.
Faute de l'employeur
Un licenciement pour inaptitude, qu'elle soit qualifiée de professionnelle ou non, ne peut pas être engagé lorsque l'inaptitude est consécutive à une faute préalable de l'employeur (Cour de cassation – Chambre sociale arrêts n° 646 du 3 mai 2018 n°16-26.306 et n° 649 du 3 mai 2018 n°17-10.306).
En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur. Cette preuve est facilitée si la faute inexcusable a été reconnue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les situations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Conclure une rupture conventionnelle sans erreur
Le guide "Rupture conventionnelle : mode d'emploi" détaille la procédure encadrée et fournit les modèles de convention et de courriers pour :
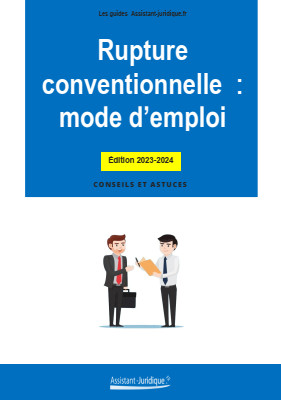
- Respecter les conditions d'éligibilité et les exclusions légales
- Suivre les formalités obligatoires (entretien, délais, homologation)
- Observer le délai de rétractation et les modalités de rétractation
- Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle légale et conventionnelle
- Conditions à remplir
- Formalités à respecter
- Délai de rétractation
- Calcul de l'indemnité de rupture
Quelle procédure respecter pour licencier un salarié pour inaptitude ?
1. Faire constater l'inaptitude par le médecin du travail
C'est le médecin du travail qui constate l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Pour cela, un examen unique suffit (accompagné des examens complémentaires le cas échéant).
Mais s'il estime qu'un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, il devra le prévoir dans les 15 jours du premier examen.
Employeur et salarié doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur les observations et propositions que le médecin du travail entend adresser.
Durant l'examen, le médecin doit donc échanger avec le salarié à propos des possibilités d'aménagement, d'adaptation, de mutation ou de changement de poste. Il doit aussi consulter l'employeur, par tous moyens.
Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut plus engager ou continuer une procédure de licenciement pour faute ou de licenciement pour motif économique. Il a l’obligation de respecter la procédure de licenciement pour inaptitude et de mettre en œuvre la recherche de reclassement y étant attachée. En cas d’impossibilité de reclassement, il pourra licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. Cesser de rémunérer le salarié
Pendant le mois qui suit l'avis d'inaptitude, l'employeur n'a pas à verser de rémunération au salarié inapte, sauf disposition conventionnelle contraire (articles L 1226-4 et L 1226-11 du Code du travail).
Pour ne pas se retrouver sans ressources, le salarié peut prendre des congés payés, percevoir des indemnités journalières s'il a un arrêt de travail ou une indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) si l'inaptitude est d'origine professionnelle.
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte et n'a toujours pas été reclassé ou licencié passé un délai de 1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le versement du salaire. Il ne peut pas obliger le salarié à prendre des congés (Cass. soc. 01.03.2017 n° 15-28.563). Aucune réduction ne peut être opérée sur le montant du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, notamment sur les heures supplémentaires ou l'indemnité de congés payés qu'il aurait perçues s’il avait travaillé (Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-19.956).
Toutefois, parallèlement, la loi prévoit qu'un salarié peut contester son avis d'inaptitude en saisissant l'inspecteur du travail dans un délai de 2 mois, sa décision pouvant elle-même être contestée dans un délai supplémentaire de 2 mois. Or la Cour de cassation considère que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude et que son avis d'inaptitude est par la suite annulé, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cas, l'employeur dispose de 2 possibilités :
- attendre pour licencier l'expiration du délai prévu pour contester l'avis d'inaptitude (2 à 4 mois) et reprendre le versement du salaire au bout de 1 mois ;
- procéder au licenciement du salarié dans le mois qui suit l'avis d'inaptitude. Il n'est alors pas tenu de lui verser à nouveau son salaire, mais prend le risque de voir ce licenciement remis en cause si le salarié conteste avec raison l'avis d'inaptitude.
Le salarié n'a pas l'obligation d'informer son employeur d'un recours. Par contre le Conseil d'État a jugé que l'inspecteur du travail devait informer l'employeur du recours pour lui permettre de présenter ses observations.
3. Tenter de reclasser le salarié
Lorsque le médecin du travail ne formule ni réserve ni restriction, l’employeur est en principe tenu à une obligation de reclassement.
Lorsque le médecin du travail indique dans son avis que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement et peut engager la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il dispose alors d'un délai de 1 mois pour proposer au salarié un (ou plusieurs) poste(s) de remplacement au sein de l’entreprise. Il est tenu de consulter les représentants du personnel ou du CSE avant toute tentative de reclassement ou de licenciement.
L'employeur doit rechercher de manière sérieuse le reclassement du salarié au besoin par mutations ou transformations de poste de travail y compris lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise.
La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise. Par « groupe », il faut donc comprendre celui dont le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français et les sociétés contrôlées par elle. Lorsque le siège social de l'entreprise dominante n'est pas situé sur le territoire français, le groupe correspond alors à l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L'employeur peut prendre en considération les critères et/ou limites posées par le salarié vis-à-vis d'un nouveau poste pour définir le périmètre de recherche d'un poste de reclassement (ex. : pas de mutation géographique). Il s'agit cependant d'une simple possibilité pour l'employeur, qui peut donc les ignorer (cass. soc. 23 novembre 2016, n° 14-26398). La procédure de licenciement n'est donc pas systématiquement invalidée au motif que des emplois disponibles dans d'autres secteurs, mais non conformes aux souhaits du salarié, ne lui ont pas été proposés.
Le télétravail doit également être envisagé par l’employeur quand il est proposé par le médecin de travail dans le cadre de la recherche de reclassement pour inaptitude, même s'il n’est pas en place au sein de la structure (Cour de cassation, 29 mars 2023 (n°21-15.472).
Si le salarié refuse, l’employeur peut :
- soit proposer un autre poste de reclassement. Le refus du salarié à la première proposition de reclassement de l'employeur ne suffit pas : l'employeur doit également établir, après recherches, qu’il ne dispose effectivement d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié (cass. soc. 30 juin 2021, n°20-14085) ;
- soit procéder à un licenciement pour inaptitude.
L'employeur n'a pas à former le salarié à un nouveau poste
L'employeur est-il contraint de proposer au salarié tout poste disponible, y compris au moyen d'une formation adaptée ?
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'employeur n'a donc aucune obligation de former le salarié afin qu'il puisse occuper un poste disponible ou qui sera disponible - à l'issue de la formation correspondante (Cass. soc. 16 mars 2016, n°13-25927).
4. Convocation à un entretien préalable de licenciement
La procédure de licenciement pour inaptitude s'apparente à celle pour motif personnel.
Une convocation à l'entretien préalable doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de l'entretien doit se situer avant la fin du mois qui suit la seconde visite médicale.
Pour que le licenciement soit valable, la convocation à l'entretien préalable doit indiquer :
- qu'un licenciement est envisagé,
- la date et l'heure de l'entretien,
- le lieu de l'entretien, même si l'entreprise n'a qu'un seul établissement,
- que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise ou, à défaut, conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale.
L'employeur doit vérifier dans la convention collective ou l'accord collectif qu'il n'existe pas de procédure particulière.
5. Notification du licenciement pour inaptitude
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement verbal est exclu.
La lettre de licenciement doit au minimum contenir :
- la mention explicite qu'il s'agit d'un licenciement ;
- les motifs du licenciement : la lettre de licenciement doit viser, non seulement l’inaptitude du salarié, mais également l’impossibilité de reclassement. À défaut d’un motif matériellement vérifiable permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- des informations relatives au préavis (pas de préavis dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude) ;
- la signature manuscrite de l'employeur ou de la personne qui le représente.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
Lorsque la lettre de licenciement pour inaptitude ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement, l'employeur a ainsi la possibilité de préciser cet élément dans les conditions fixées à l’article R 1232-13 du Code du travail.
Saisir le Conseil de Prud'hommes
Pour défendre vos droits avec méthode, le guide "Saisir le Conseil de Prud'hommes" détaille la procédure contentieuse et fournit les modèles de requête pour :

- Remplir correctement le formulaire de saisine et les annexes
- Respecter les délais de prescription et les dates limites
- Comprendre le déroulement complet de la procédure (conciliation, jugement)
- Exercer les recours possibles en cas de décision défavorable
- Formulaire à remplir
- Délai de prescription
- Déroulement de la procédure
- Recours possibles
Quelle indemnité verser au salarié licencié pour inaptitude ?
Un salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de rupture d'un montant au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf si l'inaptitude a une origine professionnelle.
Il n'y a pas de préavis ni d'indemnité compensatrice de préavis, sauf des dispositions conventionnelles le prévoient ou si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud'hommes en raison du manquement de l'employeur à ses obligations.
Dans quels cas le salarié peut-il engager la responsabilité de l'employeur ?
La responsabilité civile de l'employeur peut être engagée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si sa faute inexcusable est démontrée.
2 conditions sont nécessaires :
- l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
- et, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une indemnisation complémentaire pour le salarié, sous forme de majoration de rente, et une indemnisation spécifique de certains préjudices : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle...
Conscience du danger par l'employeur
Cette condition s'apprécie en fonction des circonstances, de la formation et de l'expérience professionnelle, de la réglementation et des habitudes de la profession mais aussi en fonction de l'évidence du danger.
La conscience du danger est considérée comme établie lorsqu'il y a eu négligence de l'employeur, volontaire ou non.
Elle a pu être retenue dans les cas suivants :
- les mesures nécessaires à l'entretien d'un appareil et de son dispositif de sécurité ont été négligées par l'employeur : par exemple, faire lever une charge dépassant la puissance maximale de l'appareil de levage ;
- l'employeur produisait ou fabriquait de l'amiante ou l'utilisait comme matière première ;
- l'employeur avait fait effectuer des analyses sur l'amiante dans les ateliers et a laissé les salariés exposés à cette matière tout en prenant des mesures pour la supprimer progressivement des produits sur lesquels travaillaient les salariés ;
- le salarié travaillait de manière habituelle à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante...
L'employeur dispose de peu de moyens de défense. En effet, il ne peut pas se prévaloir :
- d'une faute commise par le salarié (maladresse, imprudence). En revanche, celle-ci permet de réduire l'indemnisation à sa charge ;
- d'une relaxe sur le plan pénal. Il peut très bien y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur par les juridictions civiles alors qu'au plan pénal aucune faute pénale non intentionnelle n'a été constatée ;
- de la faute d'un tiers, même si elle a concouru à la réalisation de l'accident du travail.
Absence de mise en place des mesures nécessaires pour prévenir l'accident ou la maladie professionnelle
C'est au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cependant, dans certaines circonstances, la faute inexcusable de l'employeur est présumée :
- le salarié n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par la loi. Cette obligation vise le salarié en CDD, le travailleur temporaire en mission dans une entreprise utilisatrice ou un stagiaire en entreprise affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;
- le risque avait été signalé à l'employeur avant qu'il ne se produise.
Sanctionner un salarié sans erreur
Le guide "Sanctionner un salarié" détaille la procédure disciplinaire et fournit les modèles de courriers pour :

- Respecter les conditions procédurales (principe de proportionnalité, non-rétroactivité)
- Déterminer les sanctions autorisées (avertissement, mise à pied, rétrogradation)
- Observer les délais de prescription et les règles de preuve
- Utiliser les modèles de lettre de convocation, de notification et de PV d'entretien
- Conditions à respecter
- Sanctions autorisées
- Délais de prescription
- Modèles de documents
🚀 Passez à l'action avec nos guides pratiques
🎯 Pour approfondir ce thème

Guide - Licencier un salarié pour faute
✅ Conditions à respecter
✅ Faits sanctionnables
✅ Délais de prescription
✅ Modèles de documents