Comment tenir les comptes d'une association ?
Roxane Hidoux - Juriste en droit des associations |
|
Les associations qui sont tenues d'établir des comptes annuels doivent utiliser les comptes du Plan comptable associatif pour saisir leurs recettes et leurs dépenses.
 |
Pack Juridique Dirigeant Associatif |
Télécharger le pack → |
Sommaire
A quoi correspond un compte pour une association ?
Le Plan comptable associatif regroupe l'ensemble des règles régissant l'établissement et la présentation des comptes des associations qui doivent tenir une comptabilité d'engagement, c'est-à-dire une véritable comptabilité.
Une association qui doit tenir une comptabilité conforme au Plan comptable associatif doit isoler ses recettes et ses dépenses dans des catégories générales, appelées « comptes » et identifiées par un numéro.
Il existe ainsi le compte « Banques » (512), le compte « fournisseur » (401), etc. Ils peuvent être plus ou moins hiérarchisés et d'ailleurs, au besoin, l'association peut elle-même subdiviser ses comptes en rajoutant au numéro de compte un chiffre supplémentaire (par exemple 4011 pour un fournisseur en particulier et le compte 4012 pour un autre fournisseur).
La base de la comptabilité consiste à classer correctement les sommes transitant dans l'association. Par exemple, si l'association fait un chèque pour acheter un cahier, l'opération devra être enregistrée dans le compte Banques (elle a fait un chèque) et dans le compte fournisseur (elle a payé un fournisseur).
Le nombre de comptes utilisés dépend de la taille de l'association : les plus petites n'ont besoin que d'une cinquantaine de comptes alors que les plus grandes peuvent utiliser jusqu'à mille comptes.
Il ne faut pas confondre « les comptes » avec « les comptes annuels ». Les comptes annuels (ou états financiers) sont un terme réservé au bilan et au compte de résultat.
ℹ️ Retrouvez nos conseils pratiques dans le Pack Juridique Dirigeant Associatif.
Pack Juridique Dirigeant Associatif
Pour sécuriser tous les aspects de votre association, le Pack Juridique Dirigeant Associatif regroupe 17 guides pratiques :



- Créez votre association dans les règles
- Optimisez vos ressources (cotisations, dons, subventions)
- Sécurisez la gouvernance (dirigeants, AG, modifications statutaires)
- Préparez la transmission ou la dissolution
- Formalités de création
- Cotisations, dons et subventions
- Rémunération et remboursement de frais
- Assemblées générales, modification des statuts et dissolution
Quels comptes du Plan comptable associatif l'association doit-elle utiliser ?
Le Plan comptable associatif répartit les comptes en 7 catégories auxquelles il donne le nom de classe. La classe d'un compte correspond au premier chiffre de son numéro :
- Les comptes de classe 1 à 5 correspondent au patrimoine de l'association et forment le bilan de fin d'année.
- Les comptes de classe 6 et 7 illustrent les dépenses et recettes de l'association : ils sont à la base du compte de résultat.
- Le compte de classe 8 est un compte spécial, hors comptabilité, qui permet de valoriser et de comptabiliser le coût du travail effectué par les bénévoles de l'association.
Les comptes sont ensuite divisés en sous comptes (2, 3 ou 4 chiffres selon les cas) permettant de détailler précisément l'opération réalisée.
En principe, la numérotation des comptes comporte 6 chiffres. Toutefois, dans la majorité des cas, 3 chiffres suffisent, et le numéro est alors complété par des zéros pour atteindre les 6 chiffres requis.
Combien de comptes du Plan comptable associatif l'association doit-elle utiliser ?
Le nombre de comptes utilisés dépend de la taille de l'association : les plus petites n'ont besoin que d'une cinquantaine de comptes alors que les plus grandes peuvent utiliser jusqu'à mille comptes.
Le mini-plan comptable
Le mini-plan comptable, qui ne compte qu'une quarantaine de comptes, a été établi dans le respect de la loi comptable.
Il a été conçu pour répondre aux besoins de la majorité des associations (80 % d'entre elles), pour qui l'utilisation du plan comptable, même simplifié, représente un travail trop important.
Il regroupe tous les comptes correspondant aux classifications générales, c'est-à-dire ne comportant que 3 chiffres. Mais cela ne doit pas empêcher l'association d'utiliser des comptes plus précis lui paraissant indispensables.
Le plan comptable simplifié
Les associations un peu plus grandes pourront utiliser le plan comptable simplifié qui comporte à peu près 90 comptes.
Il va plus loin dans le détail que le mini-plan comptable mais n'est pas aussi détaillé que le véritable Plan comptable des associations.
Ainsi, là où le plan comptable ne comporte qu'un seul compte pour enregistrer le matériel (compte 218 « Autres immobilisations corporelles), le plan comptable simplifié distingue dans 3 comptes différents les « Installations générales, agencements, aménagements divers » (compte 2181), le « Matériel de transport » (compte 2182) et le « Matériel de bureau et matériel informatique » (compte 2183).
Le Plan comptable associatif
Les grandes associations doivent utiliser le Plan comptable associatif. Il va plus loin dans le détail que le plan comptable simplifié.
Par exemple, là où ce dernier distingue le matériel dans 3 comptes différents, le Plan comptable des associations utilise 5 comptes différents (s'y rajoutent le compte 2184 « Mobilier » et le compte 2184 « Cheptel »).
Rembourser les frais de vos bénévoles sans erreur
Pour indemniser les bénévoles en toute légalité, le guide "Rembourser les frais de ses bénévoles" détaille le cadre fiscal avantageux et fournit les modèles de notes de frais pour :

- Identifier les frais remboursables (transport, hébergement, repas, petit équipement)
- Suivre la procédure de remboursement et justifier les dépenses
- Gérer les abandons de frais et la réduction d'impôt pour le donateur
- Éviter les requalifications en rémunération dissimulée et les risques fiscaux
- Frais remboursables
- Procédure à suivre
- Abandon de frais et réduction d’impôt
- Risques à éviter
Comment une association doit-elle passer une écriture comptable ?
Une écriture comptable correspond à l'inscription d'une opération dans le logiciel de comptabilité.
Une écriture doit être passée à chaque fois qu'une opération a un impact sur le patrimoine de l'association. Il peut s'agir :
- d'une baisse ou d'une augmentation des disponibilités du fait d'une vente, de la perception d'une subvention, de cotisations ou encore d'un achat, du paiement d'impôts et de taxes.... La comptabilisation des achats et des ventes se fait sur la base des factures, chaque enregistrement comptable devant être justifié par un document soigneusement référencé et archivé : facture, bulletin de paie, déclaration fiscale, ordre de virement...;
- d'une simple modification de la composition de la trésorerie : une remise en banque d'argent liquide doit être comptabilisée comme une sortie d'argent de la caisse et une entrée sur le compte bancaire.
![]() Guide : Obtenir une subvention pour votre association →
Guide : Obtenir une subvention pour votre association →
En revanche, les opérations qui n'ont pas un impact immédiat sur l'association n'apparaissent pas dans sa comptabilité. C'est le cas de la simple prise de commandes (sauf s'il y a versement d'un acompte) ou de l'embauche d'un salarié. Une écriture comptable ne sera nécessaire que lors d'une vente ou du paiement des salaires.
Quelle que soit l'opération en cause, le mode de paiement doit toujours donner lieu à une écriture dans le compte correspondant :
- s'il est fait par le moyen d'un chèque, il doit aussi être comptabilisé dans le compte « Banques » (compte 510) ;
- s'il est fait en espèces, il faut l'inscrire dans le compte « Caisse » (compte 530) ;
- s'il s'agit d'un virement, dans le compte « Virement de fonds » (compte 580) ;
- s'il s'agit d'un chèque postal, dans le compte « Chèques postaux » (compte 514).
Pourquoi une même opération doit-elle être comptabilisée dans 2 comptes distincts ?
Dans le cadre de la comptabilité d'engagement, la réalisation d'une recette ou d'une dépense est toujours enregistrée dans 2 comptes distincts.
Pourquoi enregistrer 2 fois une même opération ? Il s'agit en réalité de la même opération vue sous 2 angles différents : une fois au débit d'un compte et une autre fois au crédit d'un autre compte. De cette façon, il sera possible de déterminer la ressource utilisée et l'emploi qui en est fait.
Le montant des 2 enregistrements doit toujours être rigoureusement identique. C'est pourquoi le bilan et le compte de résultat (états financiers réalisés en fin d'exercice) restent toujours équilibrés quelles que soient les rubriques affectées par les écritures comptables.
Comment savoir si une opération doit être classé dans la colonne débit ou crédit ?
Ces notions sont à l'origine de l'autre nom de la comptabilité d'engagement, la comptabilité en partie double. Car toute opération entraîne obligatoirement en comptabilité un double enregistrement de la même somme, d'une part au crédit d'un compte, d'autre part au débit d'un autre compte. Le montant total des écritures de débit doit donc être identique au montant total des écritures passées en crédit.
Les notions de débit ou de crédit n'ont pas le même sens que sur le relevé de banques. Ce sont de pures conventions qui imposent que la somme inscrite soit placée en débit ou en crédit du compte.
De façon synthétique, on peut dire que sont inscrites :
- au débit du compte concerné : les augmentations de biens possédés (locaux, matériel, voiture...) ou de charges d'exploitation (loyer, téléphone, assurance). Une diminution sera donc inscrite au crédit du compte ;
- au crédit du compte concerné : les augmentations de moyens de financement (mise à disposition de fonds, de crédit ou de capitaux...) ou de produits d'exploitation (ventes, dons...). Une diminution sera donc inscrite au débit.
Rémunérer un dirigeant d'association sans erreur
Pour rémunérer les dirigeants sans remettre en cause le régime fiscal de l'association, le guide "Rémunérer un dirigeant d'association" détaille le cadre légal strict et fournit les modèles de délibérations pour :

- Suivre les étapes obligatoires (décision collective, contrat écrit)
- Respecter les plafonds légaux de rémunération et les seuils d'alerte
- Maintenir le régime fiscal non lucratif et l'éligibilité aux subventions
- Calculer les cotisations sociales salariales et établir les fiches de paie
- Étapes obligatoires à respecter
- Plafonds légaux de rémunération
- Conditions pour maintenir le régime fiscal non lucratif
- Cotisations sociales et fiches de paie
En quoi consiste le report à nouveau ?
Chaque fin de mois et chaque fin d'exercice, le solde des opérations de la période précédente doit être reporté sur la ligne « report à nouveau » du mois ou de l'exercice suivant (en recettes, s'il s'agit d'un excédent ; en dépenses, si c'est un déficit).
Il peut aussi être utile de rapprocher chaque mois le solde de trésorerie du solde figurant sur le relevé de compte envoyé par l'établissement bancaire. Cela permettra de corriger rapidement les erreurs.
Quelles règles l'association doit-elle respecter au quotidien ?
De nombreux principes de base doivent être obligatoirement respectés. Ils constituent en quelques sortes un « mode d'emploi » de la comptabilité.
Chaque opération doit être comptabilisée séparément
L'association ne doit :
- ni éviter de comptabiliser les opérations portant sur de petites sommes,
- ni mélanger en une seule écriture des charges différentes payées ensemble, telles que plusieurs factures provenant d'un même fournisseur (principe de rigueur),
- ni s'abstenir de comptabiliser des recettes et des dépenses de même montant dont le solde est égal à 0 (principe de non-compensation).
Chaque opération a son importance et doit donner lieu à une écriture comptable.
Les dépenses et recettes de l'association doivent être enregistrées lors de l'exercice pendant lesquelles elles ont eu lieu
Cela permet de calculer à son terme le résultat comptable de l'association.
Il est conseillé de retenir une durée de 12 mois et de la faire coïncider avec l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ou l'année sportive, pour un club de sport (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante).
L'association doit amortir les biens (locaux, terrains, meubles)
L'amortissement consiste à retrancher chaque année une partie de la valeur du bien.
Lorsqu'une perte future est rendue probable par certains évènements (procès engagé contre l'association, impôts à payer...), elle doit aussi passer une provision (principe de prudence).
Les biens doivent être évalués à leur juste valeur
Suivant que le bien a été acheté, donné ou légué, ou fabriqué par l'association elle-même, les modalités d'évaluation de la valeur du bien diffèrent :
- S'il a été acheté, il faut prendre en compte le coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'acquisition).
- S'il a été donné ou légué, la valeur vénale (prix de vente théorique).
- S'il a été fabriqué par l'association, le coût de production (coût d'achat des matières premières et des dépenses consacrées à la fabrication : électricité, eau...).
Enfin, l'association doit bien évidemment respecter les principes suivants :
- les comptes doivent être établis en considérant que l'association continuera à fonctionner l'exercice suivant, même si ce n'est pas le cas (principe de continuité de l'exploitation) ;
- l'association doit conserver la même méthode comptable (principe de permanence des méthodes).
Pack Juridique Dirigeant Associatif
Pour sécuriser tous les aspects de votre association, le Pack Juridique Dirigeant Associatif regroupe 17 guides pratiques :



- Créez votre association dans les règles
- Optimisez vos ressources (cotisations, dons, subventions)
- Sécurisez la gouvernance (dirigeants, AG, modifications statutaires)
- Préparez la transmission ou la dissolution
- Formalités de création
- Cotisations, dons et subventions
- Rémunération et remboursement de frais
- Assemblées générales, modification des statuts et dissolution
🚀 Passez à l'action avec nos guides pratiques
🎯 Pour approfondir ce thème
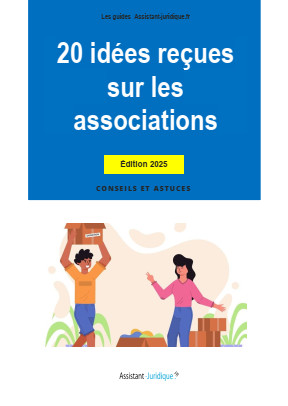 |
20 idées reçues sur les associations |



Pack Juridique Dirigeant Associatif
17 guides à jour :
✅ Création & statuts
✅ Assemblées générales
✅ Droits et devoirs des dirigeants
✅ Subventions, dons


